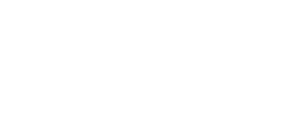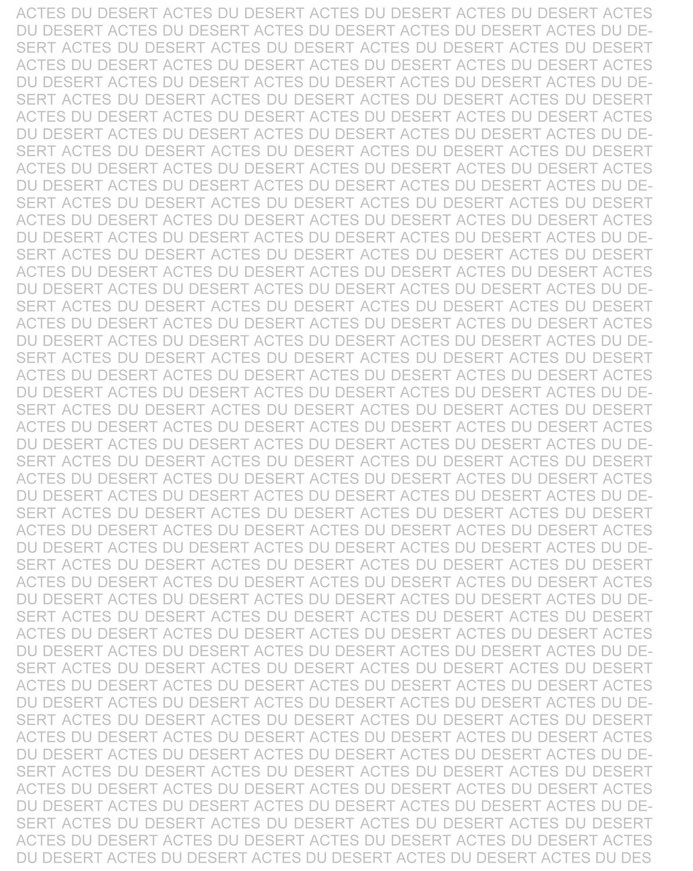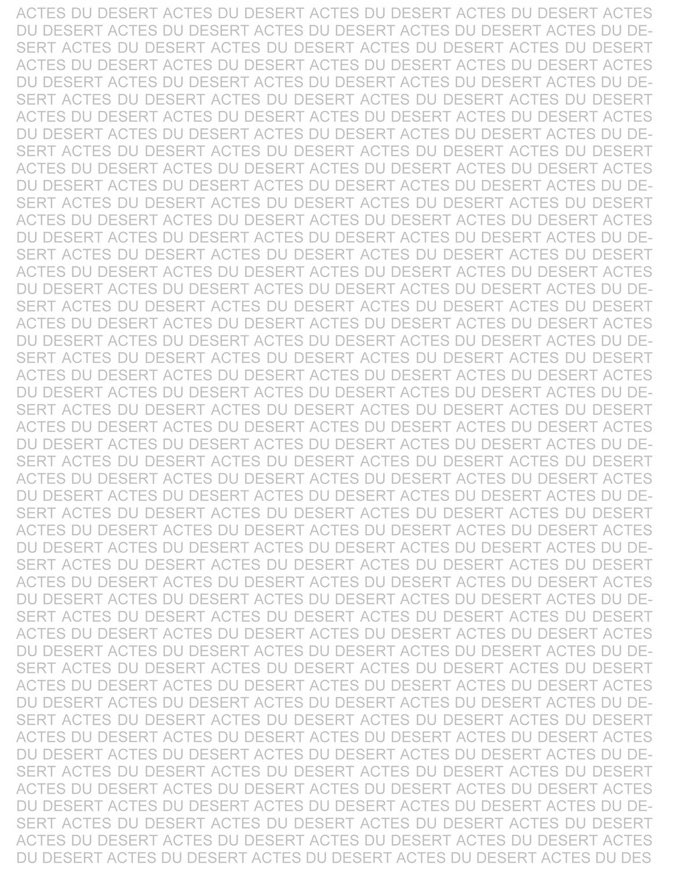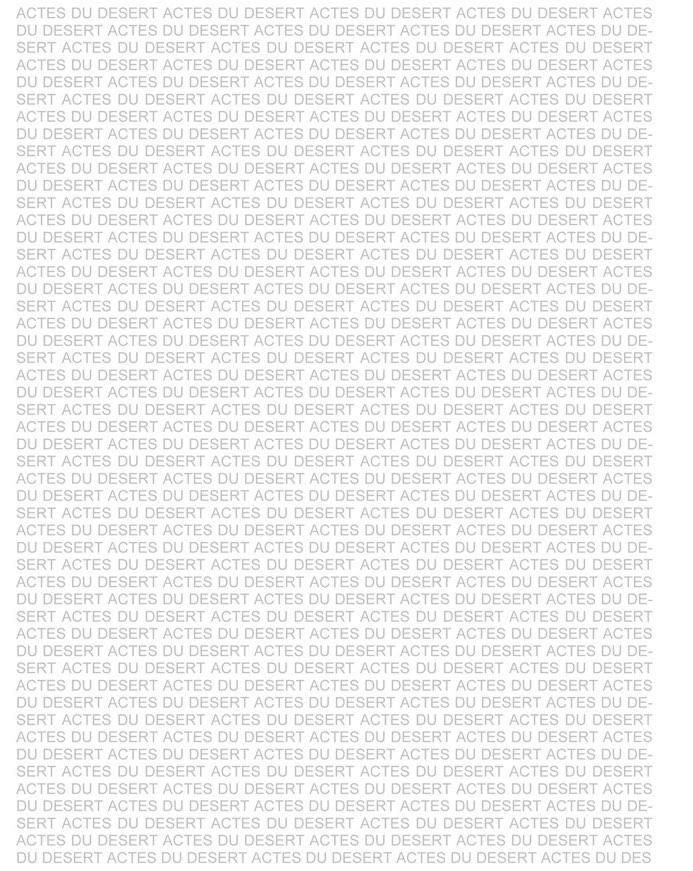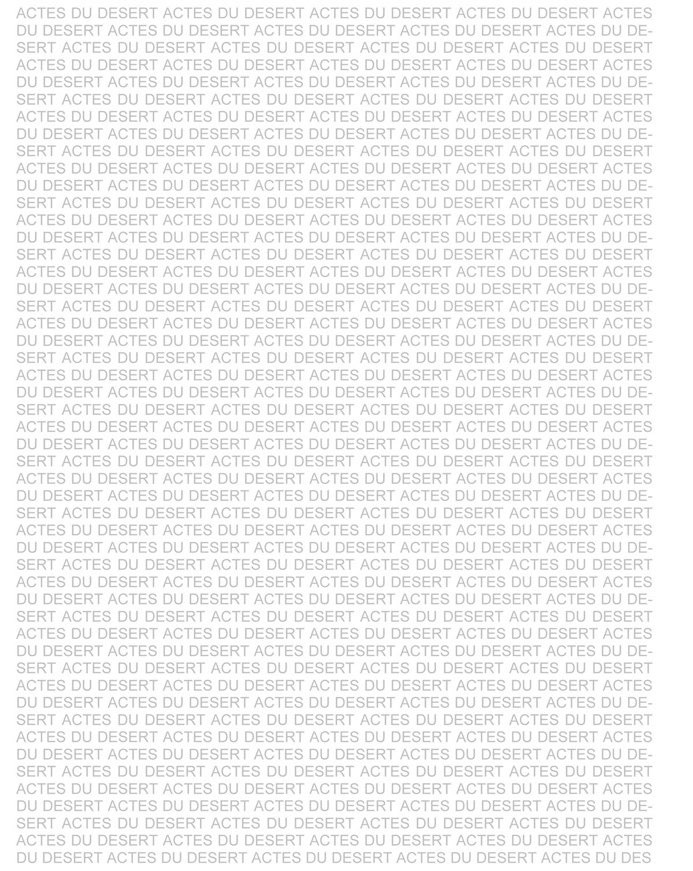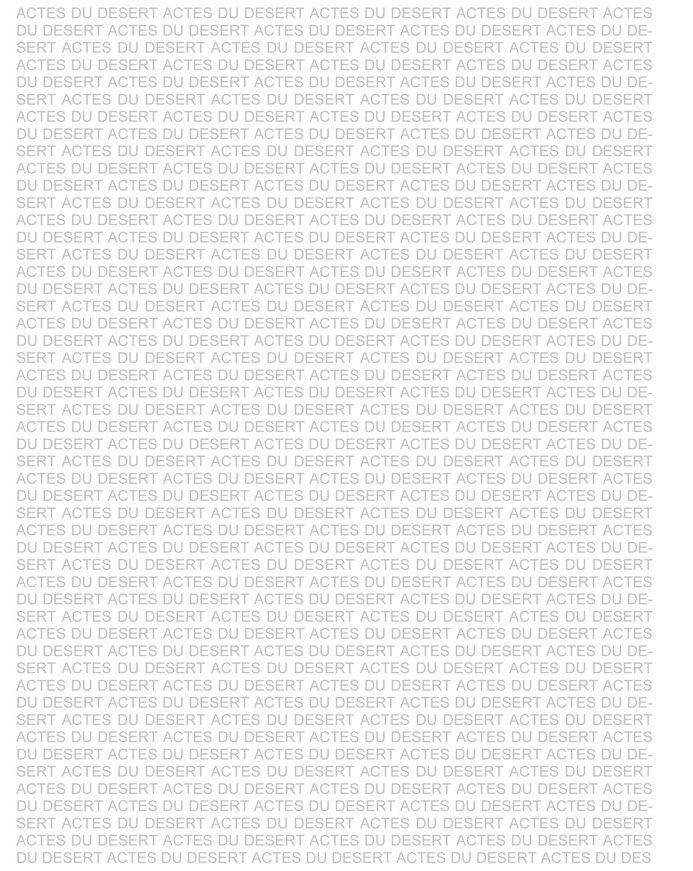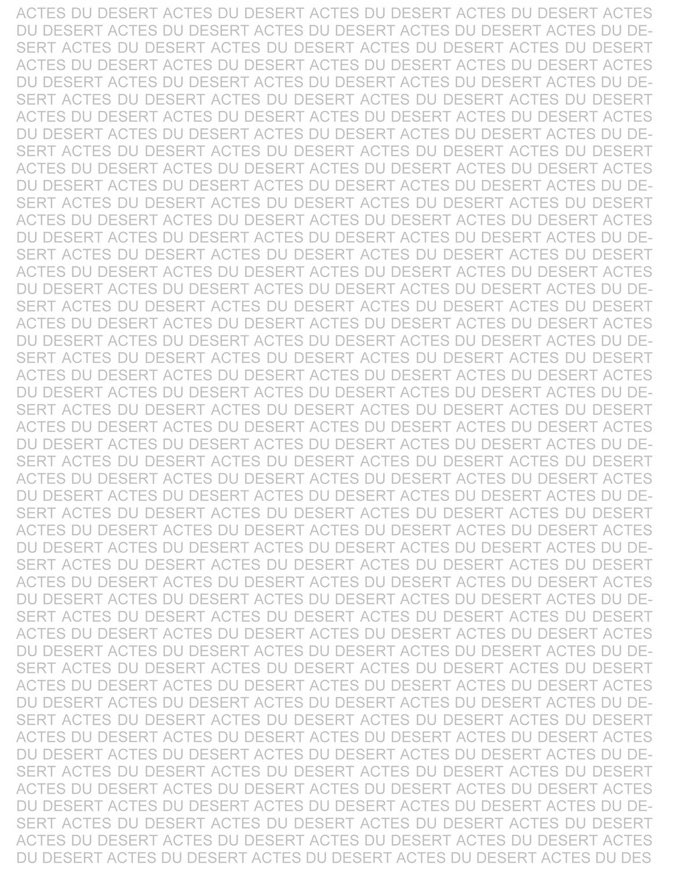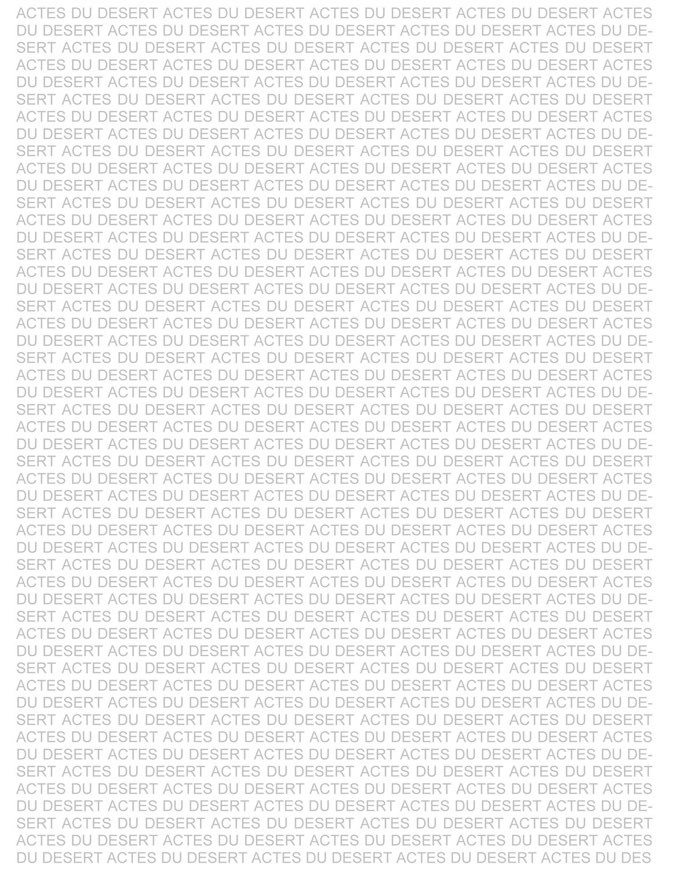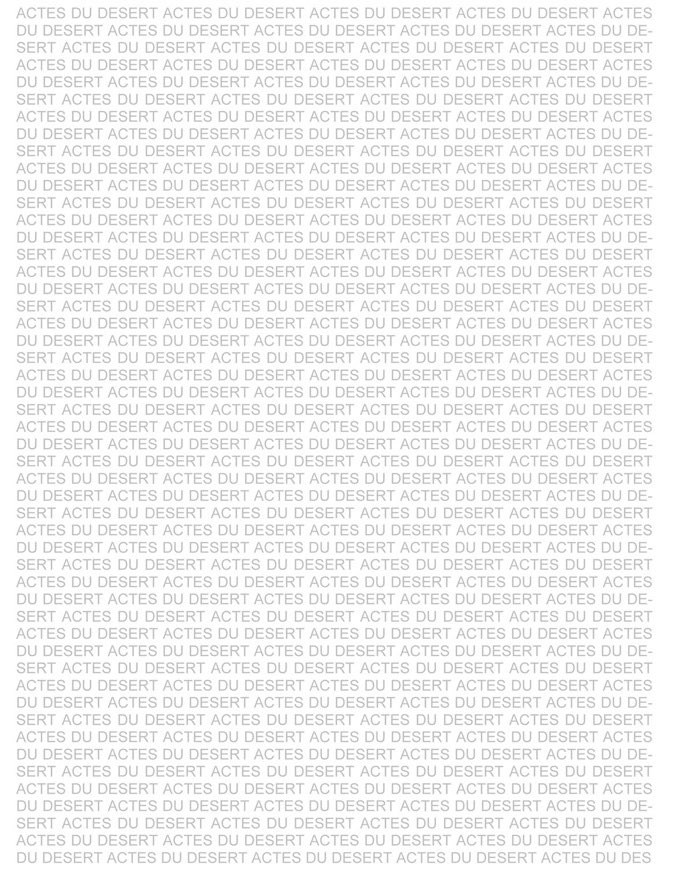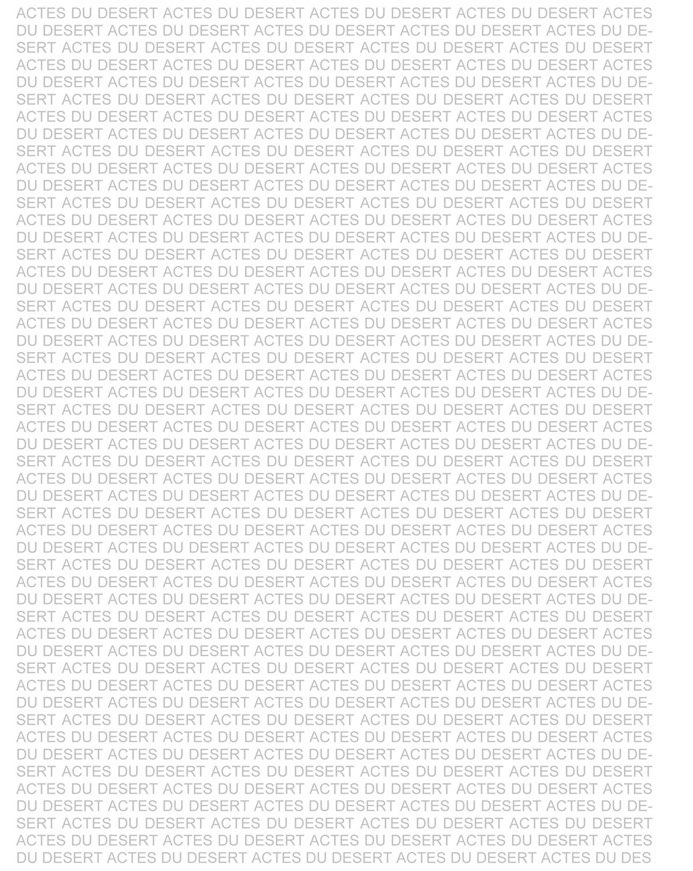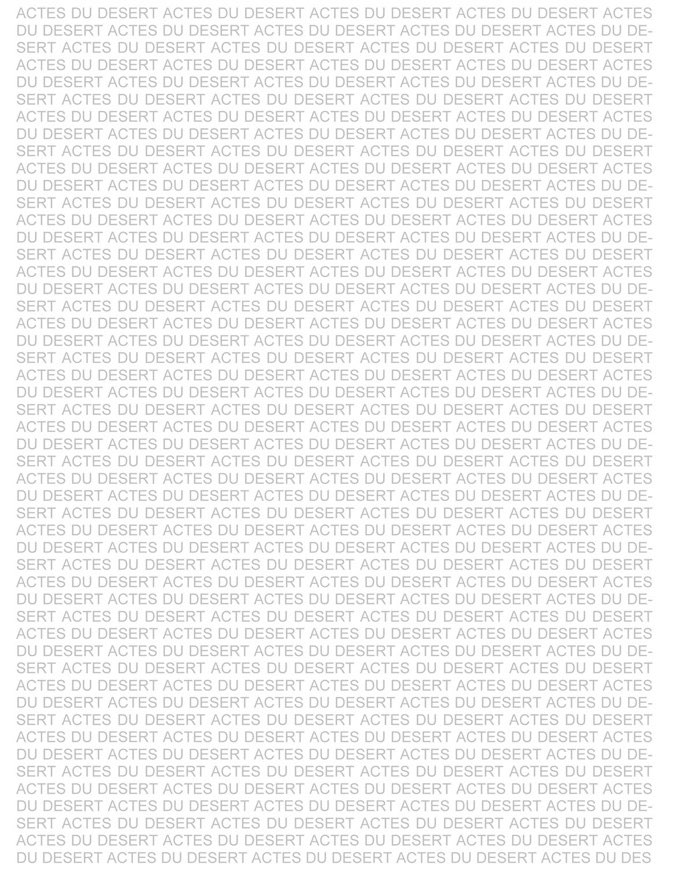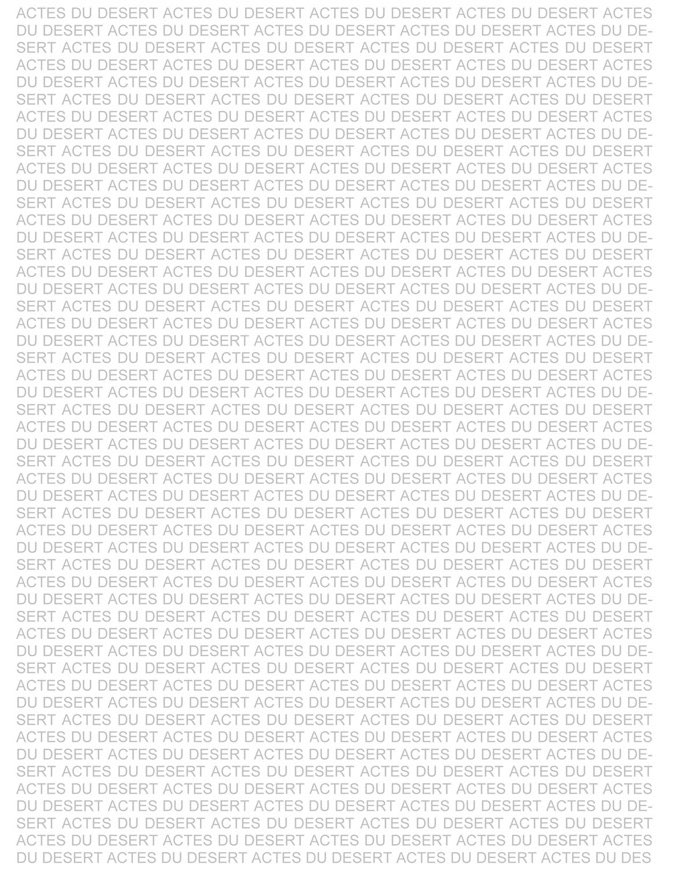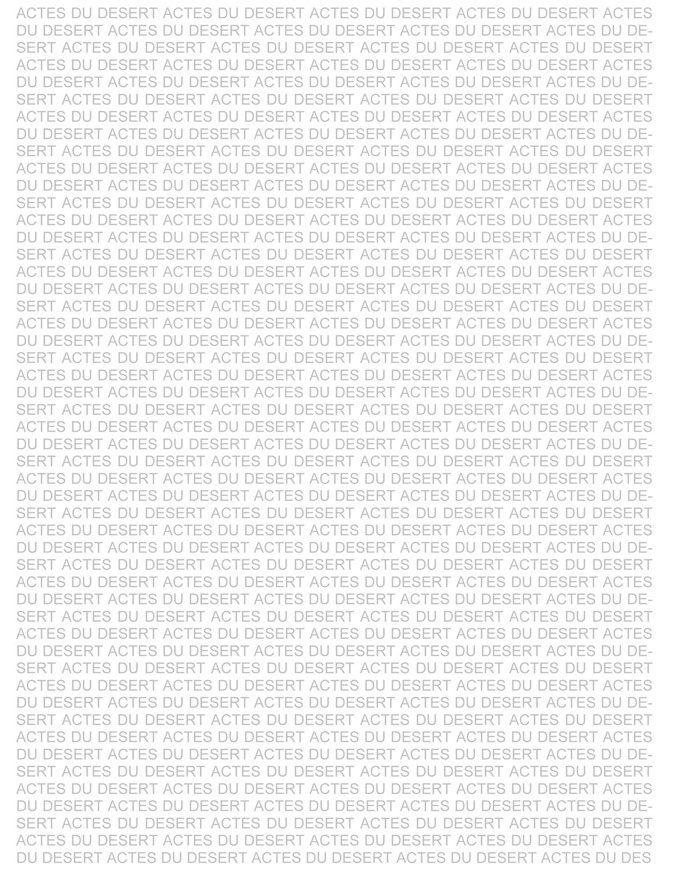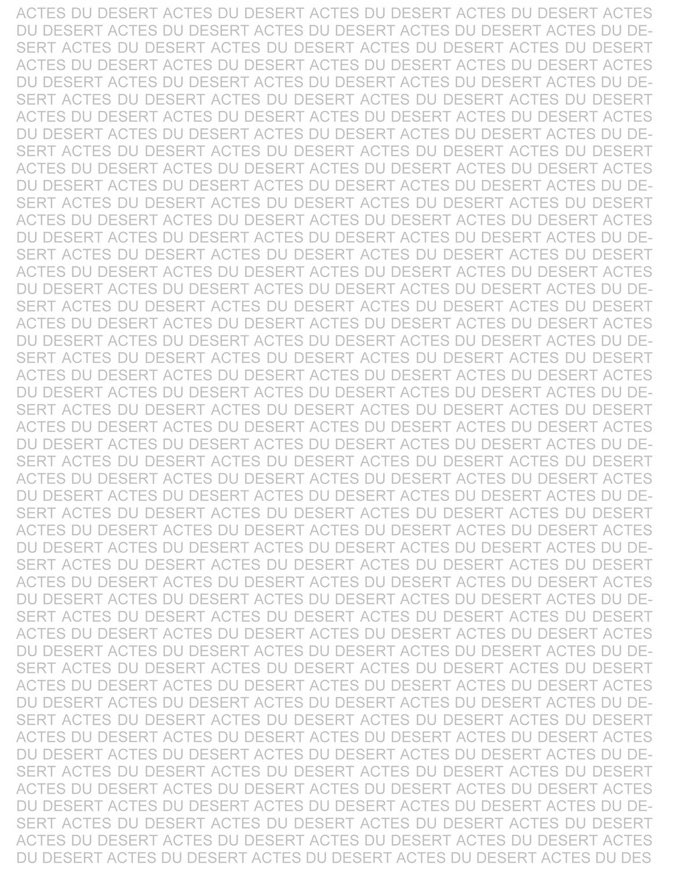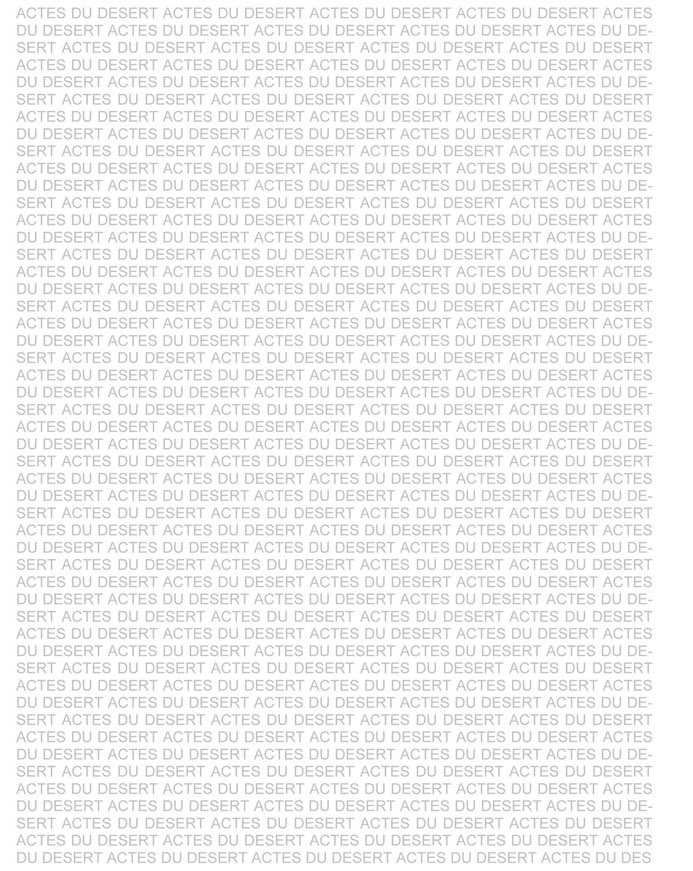JOURNAL DU DESERT
C’est le lendemain du jour initialement prévu que je suis arrivé à BAMAKO. GAËTAN et TOSH m’ont précédé en embarquant après plus de huit heures d’attente à l’aéroport de PARIS. Une triste réquisition du Ministère de l’Intérieur pour une reconduite aux frontières d’un ressortissant malien sans papiers avait bloqué les sept dernières places à l’enregistrement (dont les nôtres). Ce contretemps m’a permis de survoler, via une destination PARIS-DAKAR-BAMAKO, les terres désertiques de la MAURITANIE aux variations géologiques exceptionnelles ainsi que l’étrange et fascinant enclavement de la ville de DAKAR.
Une odeur chaude et caractéristique que j’avais sentie à mon premier voyage me remplit les poumons en sortant de l’avion sur la piste de BAMAKO.
Mon hôte X-OR m’attendait à la sortie de l’aéroport comme convenu à l’aide d’une pancarte sur laquelle était écrit : « ACTES DU DESERT ».
« Les Athéniens /auraient dit à Socrate/ que la pensée était subversive, que le vent de la pensée était un orage qui balaie tous les signes bien établis permettant aux hommes de s’orienter dans le monde, qu’il apporte le désordre dans les cités et perturbe les citoyens, particulièrement les jeunes. » /…/ « Si « une vie sans examen ne vaut pas d’être vécue », alors la pensée accompagne la vie lorsqu’elle se tourne vers des concepts tels que la justice, le bonheur, la tempérance, le plaisir, dénominations de choses invisibles que le langage met à notre disposition pour exprimer la signification de tout ce qui peut nous arriver dans la vie et se produire tandis que nous vivons. »
Hanna Arendt, Considérations morales, Conférence du 30 octobre 1970 [Texte remanié pour sa publication sous le titre Thinking and Moral Considerations : A Lecture, 1971].
Nous opterons ici pour la manière courte de l’expression, certes moins rapide que l’éclair, mais tout aussi diffuse et percutante.
Nous nous attarderons peu sur les descriptions qui n’en finissent pas et qui demandent un certain talent propre à une littérature qui nous est étrangère. Certaines descriptions seront rendues nécessaires pour recadrer notre action, notre périple. D’autres encore viendront à la rescousse pour remplacer le poids d’une analyse impossible ou trop lourde.
Notre propos n’est cependant ni léger, ni prétentieux, car il entend reproduire un instantané délicat ou magique.
Le vent du désert a pour site un esprit parfaitement silencieux.
Le vent chante le silence. Il nous rend silencieux. Quelle est cette musique ?
Nous sommes à la merci des traces que nous oublions à la marche. Elles se noient dans l’origine du monde et nous nous noyons avec elles dans un repli du temps - simple phénoménologie de l’univers.
Le repli du temps exprime le refus de l’espace dans un impossible hors-champ de lui-même.
Bien qu’il soit l’espace originel, il n’y a pas d’éternité du désert : car tout y est vide et sans histoire. De ces incessants allers et retours dans l’espace du désert, les traces que nous laissons donnent matière au vide, et le vide est l’essence de toutes ces variations polymorphes.
Les êtres ne se fatiguent pas d’aller et venir vers et entre les choses distinctes données dans l’espace de par leur existence spécifique et indépendante. C’est le grand festin de la vie. Etre là, dans un espace indéfini, c’est festoyer. Que de fourmis auront accompagné nos mets délicats.
Nous zigzaguons. Nous marquons une hésitation.
I.
Je sais que tu as mal
Que tu as mal d’être là
Et que le mal est la chose au monde la mieux partagée
Tout cela, je le sais
Je ne puis même rien pour toi
Pour cette chose-là qui te tient
Et qui te cloue en ce lieu
Qui que tu sois
Où que tu te tiennes
Mais est-ce bien le partage de la chose
Entre toi et le monde
Qui ne répond pas à la chose
Entre toi et les autres ?
II.
Reprenons à la chose ce qui t’appartient
Reprenons ce que tu as peut-être mal saisi
Mais reprends-moi si je me trompe
La chose est là
Tout à toi, et je la vois en trompe-l’œil
Elle te tient sempervirens au plus près
Ce n’est pas le doute qui habite cela
Dis-le moi
Si cela maintenant t’a toujours tenu au plus près
Et même te tiendrait au plus près des autres
N’y-a-t-il de fait que le monde de la chose
Ou mieux encore pas plus de chose que de monde
En partage ?
Dis-le moi
Si ce monde enfin est assez vaste pour les autres
Mais pas assez pour être à toi
(Trop vaste peut-être)
Nomme-le moi
Et si le monde et la chose à la fin te contenaient
Quand bien même tu t’en détacherais sans quelque dommage
Que t’arriverait-il ?
La modification réflexive de notre volonté d’agir, en créant son point d’ancrage dans un espace indéfini, nous engage à orchestrer la continuité désirable de notre vie à l’appui d’une geste délibérée ou automatique qui mènerait d’un malaise très relatif à son absence de lieu.
L’expression de cette continuité [le lieu de son absence], avec tout ce qu’elle comporte de plaisir ou de déplaisir, se veut salutaire.
C’est à la circonscription même d’un cercle [qui relève le défi du temps dans un espace indéfini] que nous cessons et ne cessons pas d’exister instantanément. Il y a là un défi sans nom, sans commencement ni fin. Mieux encore, si notre raison d’exister était ailleurs et partout ailleurs, là où nous pourrions nous tenir encore et toujours nous ramènerait au même point d’ancrage de notre situation.
Mais de quelle indécision s’agit-il ? De quel point d’ancrage ?
Etre là, et pourtant paradoxalement ne jamais y être, nous a permis de dire [en le dénonçant] : « Ci-gît, le point. »
Que de myriades d’efforts ainsi répétés à travers d’innombrables tourbillons d’époques et de migrations balayées par le vent auront contribué à sauver un grain de sable. Et si cela n’était rien d’autre qu’un écho sans retour ? Pourtant, le prix à payer de cet effort ne sera ni supérieur, ni inférieur à ce que nous rapporterait une infime parcelle d’oasis.
La récompense excède largement la pensée.
Ci-gît, le point. Ci-gît, le grain.
Face à soi, la pensée du monde excède la pensée des autres, sans les autres. C’est tout ce que nous pouvons faire ensemble, séparément. Nous sommes absents du monde à force d’avoir intériorisé la pensée des autres et balayé malgré un effort répété, mais vain, le partage de ce monde en récompense. C’est notre migration intérieure. Toute pensée émet un coup de dés en se regardant agir dans un sablier.
Il convient d’invoquer la force du vent pour nommer musique du silence chaque parcelle du sol qui ondule.
L’espace se précise à mesure que le sablier se vide et se remplit.
A l’intérieur d’un cercle désormais circonscrit ou à la ligne de démarcation entre un paysage intérieur et un paysage extérieur, nous avons tiré au cordeau une histoire sans importance.
Sans l’ombre d’une tristesse, plus confortée dans son action permissive sous un soleil qui rayonne d’une lumière si intense, notre écriture reste muette à mesure que notre langage s’estompe. Il en va de notre langue comme d’un vide sonore.
A rebours :
III.
Goudron ouvert à l’infini
Route balayeuse de poussière
Goudron mauve aux reflets bleus
Bordé de bandes lisses ocre-marron
Puis, alentour, finesse végétale
D’un jaune paille, plus pâle que jaune
Parsemée de touffes sèches d’un vert Corot ou Véronèse
Où se dressent tant de fantomatiques baobabs
Goudron ouvert à l’infini
Tu nous traces tes appels au voyage
Sur une route balayée de poussière.
Il en va aussi de l’avenir de notre parcours géographique comme de la résolution ou non d’un problème économique car un seul et même désir poursuit son cours libérateur depuis plusieurs siècles d’itinérance. Alors, commence la chasse aux traces dans un décor qui nous comble et nous détermine.
De même que certains ont faim de leur histoire au sein d’une assemblée constituée [forme d’esthétisation allant de la haine de soi jusqu’au mépris de l’autre], de même nous aimons nous épuiser dans un territoire indistinct, tout aussi réel et qui confirme la fiction.
L’oubli est notre passion dominante.
IV.
C’est quoi ça, que tu maudis
Que tu me dis que tu sais
Que je ne suis ici ou là, eh oui
Toi, qui sais si bien cela
Du mal et du bien, à poil
Du peu de bien, si mal appris
C’est quoi tout ça, que tu me veux
D’un aveu, ô jamais si peu
Et ça, puis ça, et zou
Ce que tu veux que je ne sais
Face à toi, ici seulement pour ça
Non, plus jamais cela.
Tout autour d’un cercle délimité par une ligne de sable d’une coloration autre que locale, une soixantaine de feuilles ont été disposées à égale distance et recouvertes parcimonieusement de sable offrant ainsi à la vue un dispositif de cloisonnements qui relève d’une géométrisation chromatique aux accents mondrianesques [bleu, rouge, jaune, gris, noir et blanc].
Qui va là ? Dites-moi qui vous êtes ? Que venez-vous chercher ici et plus particulièrement dans ce cercle ?
(Il a suffi qu’un danseur se déplace pour que son dynamisme métamorphose nos signes.)
Je marche sur nos traces, oui, nos traces, dès lors qu’elles révèlent une parfaite apparence de transformation du sol et des choses qui s’y trouvent sous l’invocation de paroles restées muettes à ce jour et ce, dans la mesure où l’union au cosmos implique un abandon de toute stratégie individuelle.
Je foule dans ce lieu plus précis une multitude indénombrable de grains de sable comme si un mouvement quelconque ici-bas me permettait de vérifier pas à pas que la force magnétique qui se dégage des traces [et des figures conjointes] agissait toujours plus mystérieusement sur un ensemble de faits et gestes sécularisés.
Aller et venir, en somme, au milieu de ce territoire, dans un sens ou dans un autre, revient à vivre une forme d’ouverture à la façon dont un guide m’orienterait à partir d’un point [vers une ou plusieurs lignes directrices] jusqu’à la racine des choses.
V.
Vous me direz si je dois rentrer en moi
J’attends
Vous me direz aussi ce que je dois faire là-dedans
Le temps me perd (malgré l’aubaine) à ne rien faire
J’attends que tout cela cesse
Petites fichaises, petits émois là-dedans
Coins de conversation aux quatre coins d’une antichambre
Petits coins de séparation
Où l’on traite d’une réparation, l’autre
Instinct du parlementaire yes, prompt à l’instant
Relève de la garde qui pense haut de omni re
Et puis, res, res, res idoine qui vive et vaille
Langue en torchis pour soubrette
J’attends, vous dis-je.
Lorsque le vent du désert a soufflé sur nos signes, nous avons émigré vers d’autres lieux.
De ce dialogue inassouvi entre racines et ouverture, que nous reste-t-il plus exactement à découvrir ?
Les pistes qui mènent au véritable désert sont parsemées de cadavres ; il n’y manque que le nôtre.
Soleil en jus saupoudré de sable.
JPHAMON